Charles Joseph Minard
| Naissance | |
|---|---|
| Décès |
(à 89 ans) Bordeaux |
| Nationalité | |
| Formation | |
| Activités |
Charles Joseph Minard (né le à Dijon, Côte-d'Or, et mort le à Bordeaux, Gironde) est un ingénieur civil français célèbre pour ses inventions dans le domaine de la traduction graphique et cartographique appliquée au génie civil et aux statistiques. Plus méconnus mais néanmoins réels sont sa réflexion et son apport sur l'utilité collective et son analyse de la tarification des équipements publics (péage).
Biographie
[modifier | modifier le code]Charles-Joseph Minard est né le à Dijon sur la paroisse Saint-Michel. Il est le fils de Pierre Étienne Minard, greffier de la maréchaussée, et de Bénigne Boiteux, son épouse. Il est baptisé en l'église Saint-Michel ce même jour. Son parrain est Charles-Joseph Boiteux, ancien conseiller du roi, notaire en cette ville, son aïeul maternel, et sa marraine est Marguerite Gilbert, épouse de maître Jacques Minard, avocat à la Cour, sa tante paternelle.
Ancien élève de l’École polytechnique puis de l’École nationale des ponts et chaussées, Minard travaille de nombreuses années dans le génie civil (construction de barrages, de canaux — dont ceux du Centre, de Saint-Quentin et de Charleroi — et de ponts dans toute l’Europe). De 1830 à 1839, il est inspecteur des études de l’École des Ponts et Chaussées. De 1839 à 1851, année de sa mise à la retraite, il est nommé inspecteur des ponts et chaussées et poursuit ses travaux sur la représentation graphique des séries statistiques durant toute sa retraite.
Œuvre
[modifier | modifier le code]L'usage de l'illustration graphique en statistique
[modifier | modifier le code]
Minard fait œuvre de pionnier dans l’utilisation des graphiques appliqués au génie civil et aux statistiques. Il atteint la célébrité pour sa Carte figurative des pertes successives en hommes de l'armée française dans la campagne de Russie 1812-1813, une représentation graphique publiée en 1869 relative à la désastreuse campagne de Russie entreprise par Napoléon en 1812. Ce célèbre graphique présente plusieurs variables dans une simple image en deux dimensions :
- localisation et itinéraire de l’armée indiquant les points de séparation et de regroupement des unités ;
- pertes humaines de l’armée (particulièrement sensibles lors de la traversée de la Bérézina) ;
- variations de la température de l’air au cours de la retraite.
Étienne-Jules Marey met l'accent sur la « brutale éloquence » de ce graphique, qui « semble défier la plume de l’historien » ; il souligne aussi les « effets saisissants » des autres travaux de Minard[2]. Pour Edward Tufte, il pourrait s'agir là du « meilleur graphique statistique jamais tracé », et il en fait un exemple de la plus haute importance[3]. Howard Wainer (en) le présente comme un « bijou » de l’information graphique et le qualifie de « candidat pour le titre de champion du monde du graphique »[4].
Minard crée de nombreuses autres cartes du même type ; Arthur H. Robinson en compte ainsi 51 en tout[5]. Elles portent sur des sujets divers[6].
En 2002, Michael Friendly (en) revisite le travail de Minard en utilisant des systèmes modernes de visualisation de l'information tels que SageMath et Mathematica[7].
-
La Carte figurative et approximative des quantités de viandes de boucherie envoyées sur pied par les départements et consommées à Paris[8] (1858) utilise des diagrammes circulaires.
-
Carte figurative et approximative des quantités de coton en laine importées en Europe en 1858 et en 1862[9] (1864).
-
Tableau figuratif du mouvement commercial du Canal du Centre en 1844. Ce graphique est un des premiers graphiques mosaïque de l'histoire[10].
-
Carte figurative relative au choix de l'emplacement d'un nouvel Hôtel des Postes de Paris[11] (1865).
-
Tableaux figuratifs de la circulation de quelques chemins de fer, publié dans Des Tableaux et des cartes figuratives par Charles Joseph Minard en 1862.
Pionnier de l'analyse de la gestion publique
[modifier | modifier le code]Un manuscrit envoyé à Jean-Baptiste Say par Minard en 1832[12] contient l'essentiel des progrès des analyses économiques en matière de gestion publique. Travaux repris par Jules Dupuit dont la postérité n'a retenu que le nom, « en jetant une ombre sur ceux du véritable pionnier »[12].
Minard réfléchit et répond dans les années 1820 aux interrogations posées par les équipements publics :
- Les canaux construits se révèlent moins rentables que prévu et leur achèvement est parfois remis en question.
- Pour le financement des routes, il s'agit de trancher entre la budgétisation, le paiement selon l'usage ou le paiement selon la dégradation de la voie.
Sa réflexion le conduit à s'interroger plus généralement sur la finalité des travaux publics : la production d'utilité collective publique notamment en matière de transport). Minard pense que celle-ci peut être déterminée de façon assez précise et que cette valeur dépend de la demande et de la répartition des revenus. Les besoins les plus essentiels sont prioritaires (ceux des plus pauvres). Pour le reste, la décision doit tenir compte des délais de production et de l'économie de temps permise par l'équipement (bénéfice social déterminé en temps puis en valeur) , avec une prise en compte des intérêts composés (les dépenses étant étalées sur plusieurs années).
Distinctions
[modifier | modifier le code] Commandeur de la Légion d'honneur (2 mai 1849)[13]
Commandeur de la Légion d'honneur (2 mai 1849)[13]
Publications
[modifier | modifier le code]- Charles Joseph Minard, Des tableaux graphiques et des cartes figuratives, Paris, impr. de Thunot, .
- Charles Joseph Minard, Notions élémentaires d'économie politique appliquées aux travaux publics, in Annales des ponts et chaussées, Mémoires et documents, tome XIX, 2ème série, 1er semestre, Paris, Carilian-Gœury, 1850, pp. 1-125 (NB : article écrit en 1832).
- Charles Joseph Minard, Leçons faites sur les chemins de fer à l’École des ponts et chaussées en 1833 - 1834, Paris, Carilian-Gœury, 1834.
Bibliographie
[modifier | modifier le code]- Victorin Chevallier, « Notice nécrologique sur M. Minard, inspecteur général des ponts et chaussées, en retraite », Annales des ponts et chaussées : Mémoires et documents, Paris, Dunod, 5e série, vol. II, 2e semestre 1871, p. 1–22 (lire sur Wikisource).
- Étienne-Jules Marey, La Méthode graphique dans les sciences expérimentales, Paris, G. Masson, , 673 p. (lire en ligne).
- Gilles Palsky, Des chiffres et des cartes : Naissance et développement de la cartographie quantitative française au XIXe siècle, Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, coll. « Mémoire de la section de géographie physique et humaine » (no 19), , 331 p. (ISBN 2-7355-0336-3 (édité erroné)).
- (en) Edward Tufte, The Visual Display of Quantitative Information, Cheshire (Connecticut), Graphics Press, , 2e éd., 197 p. (ISBN 0-9613921-4-2).
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Carte figurative des pertes successives en hommes de l’Armée française dans la campagne de Russie en 1812-1813 », Tableaux graphiques et cartes figuratives, sur Gallica.
- ↑ Marey 1878, p. 73 [lire en ligne].
- ↑ Tufte 2001, p. 40.
- ↑ (en) Howard Wainer (en), « How to Display Data Badly », The American Statistician, American Statistical Association, vol. 38, no 2, , p. 146 (137–147) (lire en ligne).
- ↑ (en) Arthur H. Robinson, « The Thematic Maps of Charles Joseph Minard », Imago Mundi (en), vol. 21, , p. 95–108 (JSTOR 1150482).
- ↑ (en) Michael Friendly (en), « The Graphic Works of Charles Joseph Minard », Université York, .
- ↑ (en) Michael Friendly (en), « Visions and Re-Visions of Charles Joseph Minard », Journal of Educational and Behavioral Statistics, vol. 27, no 1, , p. 31–51 (lire en ligne).
- ↑ « Carte figurative et approximative des quantités de viandes de boucherie envoyées sur pied par les départements et consommées à Paris », Tableaux graphiques et cartes figuratives, sur Gallica.
- ↑ « Carte figurative et approximative des quantités de coton en laine importées en Europe en 1858 et en 1862 », Tableaux graphiques et cartes figuratives, sur Gallica.
- ↑ (en) Michael Friendly (en), « A Brief History of Data Visualization », dans Chun-Houh Chen, Wolfgang Härdle et Antony Unwin, Handbook of Data Visualization, Springer-Verlag, coll. « Springer Handbooks of Computational Statistics », (ISBN 978-3-540-33036-3, DOI 10.1007/978-3-540-33037-0_2), p. 29.
- ↑ « Carte figurative relative au choix de l'emplacement d’un nouvel hôtel des Postes de Paris », Tableaux graphiques et cartes figuratives, sur Gallica.
- Maurice Baslé, Françoise Benhamou et Bernard Chavance, Histoire des pensées économiques, vol. 1 : Les fondateurs, Paris, Sirey, coll. « Synthèse + », , 2e éd., 422 p. (ISBN 2-247-01666-9).
- ↑ « Recherche - Base de données Léonore », sur www.leonore.archives-nationales.culture.gouv.fr (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Michael Friendly (en) (trad. Julie Ordonez), « Biographie de Charles Joseph Minard », sur Anovi – XIXe siècle.
- (en) Virginia Tufte (en) et Dawn Finley, « Minard's sources: Books Probably Used by Minard on Napoleon in Russia », sur edwardtufte.com, .
- Sandra Rendgen (trad. Jasmine Rivière-Poupon), « Les cinquante cartes de Charles-Joseph Minard », sur Visioncarto, .
- « Cartes et documents de Ch.-J. Minard », sur Bibliothèque numérique patrimoniale de l'École des ponts et chaussées, École nationale des ponts et chaussées (consulté le ).
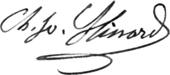
![La Carte figurative et approximative des quantités de viandes de boucherie envoyées sur pied par les départements et consommées à Paris[8] (1858) utilise des diagrammes circulaires.](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Minard-carte-viande-1858.png/120px-Minard-carte-viande-1858.png)
![Carte figurative et approximative des quantités de coton en laine importées en Europe en 1858 et en 1862[9] (1864).](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/Carte_figurative_et_approximative_des_quantit%C3%A9s_de_coton_en_Europe_en_1858_et_1862.png/120px-Carte_figurative_et_approximative_des_quantit%C3%A9s_de_coton_en_Europe_en_1858_et_1862.png)
![Tableau figuratif du mouvement commercial du Canal du Centre en 1844. Ce graphique est un des premiers graphiques mosaïque de l'histoire[10].](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Tableau_figuratif_du_mouvement_commercial_du_Canal_du_centre_en_1844.jpg/120px-Tableau_figuratif_du_mouvement_commercial_du_Canal_du_centre_en_1844.jpg)
![Carte figurative relative au choix de l'emplacement d'un nouvel Hôtel des Postes de Paris[11] (1865).](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Carte_figurative_relative_aux_choix_de_l%27emplacement_d%27un_nouvel_H%C3%B4tel_des_Postes_de_Paris.jpg/120px-Carte_figurative_relative_aux_choix_de_l%27emplacement_d%27un_nouvel_H%C3%B4tel_des_Postes_de_Paris.jpg)
