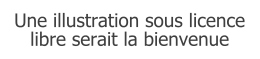Hélène Rytmann
| Naissance | |
|---|---|
| Décès | |
| Sépulture | |
| Nom de naissance |
Hélène Rytmann |
| Pseudonyme |
Hélène Legotien |
| Nationalité | |
| Activités | |
| Conjoint |
Louis Althusser (de à ) |
| Parti politique | |
|---|---|
| Conflit |
Hélène Rytmann, dite Hélène Legotien ou Hélène Legotien Rytmann, née le à Paris dans le 18ème arrondissement[1], morte assassinée le Paris dans le 5ème arrondissement[2], est une résistante et sociologue française.
Elle est militante communiste dans la résistance française au nazisme. Membre du Parti communiste français, elle en est exclue après des accusations de trotskysme et pour avoir participé à des exécutions sommaires d'anciens collaborateurs nazis.
Hélène Rytmann est tuée par strangulation en 1980 par son mari Louis Althusser. Son meurtre attire beaucoup d'attention de la part des médias français et Althusser est appelé à être condamné comme un criminel ordinaire, mais il est déclaré inapte à être jugé pour cause de folie (article 64 du code pénal, abrogé en 1994) et interné dans un établissement psychiatrique pendant trois ans[3].
Biographie
[modifier | modifier le code]Jeunesse
[modifier | modifier le code]Hélène Rytmann est née à Paris en 1910 dans une famille juive d'origine russe et lituanienne. Selon Louis Althusser, Hélène Rytmann a subi des agressions sexuelles dans son enfance par son médecin de famille. Alors qu'elle a 13 ans, le médecin la force à administrer une dose mortelle de morphine à son père qui souffre d'un cancer en phase terminale ; l'année suivante, elle est forcée à administrer une autre dose mortelle à sa mère en phase terminale. Cependant, cette histoire aurait pu être inventée par Althusser, qui a admis avoir incorporé des « souvenirs imaginaires » dans sa « traumabiographie »[4],[5].
L'un des frères d'Hélène, Joseph Rytmann, est propriétaire de plusieurs salles de cinéma à Paris, notamment Le Bretagne à partir de 1933[6].
Activités au sein de la Résistance
[modifier | modifier le code]Pendant l'occupation allemande de la France, elle refuse de porter l'étoile jaune demandée par les nazis et rejoint la résistance française[7]. En tant que militante, elle est une camarade de Jean Beaufret et est affiliée à la division « Périclès » de la résistance française. Elle rejoint le Parti communiste français, mais est ensuite exclue pour « déviation trotskyste » et « crimes ». Elle est accusée d'avoir participé à des exécutions sommaires d'anciens collaborateurs nazis à Lyon. Hélène Rytmann est aussi parfois connue sous le nom d'Hélène Legotien ou Hélène Legotien-Rytmann, son nom de couverture pendant la Résistance française étant « Legotien »[8].
Carrière en sociologie
[modifier | modifier le code]Entrée à l'Organisation européenne de coopération économique comme « varitypiste » en 1951[9], Hélène Legotien en ressort chargée d'études en 1955. La même année, elle rejoint une équipe d'une cinquantaine d'enquêteurs qui, sous la direction d'Alain Touraine, réalisent une enquête de grande ampleur sur « la conscience ouvrière ». Dans ce cadre, Hélène Legotien est envoyée faire du terrain auprès des ouvriers de Montceau-les-Mines. Elle collabore ensuite à l'enquête que Pierre Naville consacre, entre 1957 et 1959, à l'automation et au travail humain. Seule femme envoyée sur le terrain, elle étudie les modifications de l'organisation du travail à l'Imprimerie nationale et co-rédige le chapitre 3 du rapport d'enquête dirigé par Naville[10].
En 1959, Hélène Legotien est embauchée par la SÉDÉS (Société d'études pour le développement économique et social). Au sein de cette filiale privée de la Caisse des dépôts et consignations, elle effectue des tâches de documentation avant d'être chargée d'études et de rédiger plusieurs rapports de sociologie rurale qui examinent de manière critique les conséquences du développement de l'agriculture commerciale en France comme dans les anciennes colonies françaises d'Afrique subsaharienne. Avec ses supérieurs et ses collègues économistes, elle plaide pour la conception d'opérations de développement rural plus légères et prenant davantage appui sur le savoir agraire des populations locales[11]. Sur le plan méthodologique, elle préconise également l'adoption de méthodes d'enquête légères et s'inspire de la démarche du sociologie d'intervention italien Danilo Dolci[12].
En , elle prend sa retraite et quitte la SÉDÉS. Cette retraite ne l'empêche pas de continuer de mener des enquêtes sociologiques. Lorsqu'elle est tuée par son mari le , Legotien était impliquée dans une enquête collective sur la mémoire ouvrière et le changement social à Port-de-Bouc.
Meurtre
[modifier | modifier le code]Le , Hélène Rytmann est tuée par son mari par strangulation dans leur appartement de l'École normale supérieure. Son mari lui écrase le larynx et la tue. Le meurtre n'a jamais fait l'objet d'une enquête approfondie. En janvier 1981, Louis Althusser est jugé inapte au procès en vertu de l'article 64 du code pénal français, le juge réclamant une « responsabilité diminuée » en raison d'une maladie mentale[7].
Hélène Rytmann est enterrée dans la section juive du cimetière parisien de Bagneux à Paris[13].
Réflexions rétrospectives sur le féminicide
[modifier | modifier le code]Dans un article scientifique paru en [14], Francis Dupuis-Déri montre que « tout de suite s’impose dans l’espace public la thèse de la folie pour expliquer ce cas. Toute analyse sociologique ou politique, pour ne pas dire féministe, est évacuée ». Les arguments psychologiques permettent à Louis Althusser de se disculper dès l’instruction - il n’est d’ailleurs pas placé en garde à vue - et dans les médias. « Althusser a déployé beaucoup d’énergie pour se présenter comme fou, et donc irresponsable du meurtre, alors qu’il était reconnu comme un érudit rationnel, » écrit Francis Dupuis-Déri. Il précise que « dans les minutes et les heures qui ont suivi le meurtre, Althusser a bénéficié de l’appui indéfectible de la direction de l’École normale supérieure, de ses thérapeutes, de ses amis et de ses disciples, qui ont constitué une ligne de défense avant que les autorités judiciaires se saisissent de l’affaire ». Il observe enfin que le meurtre d’Hélène Rytmann présente les caractéristiques d’un féminicide, même si cette notion n’existait pas en tant que telle à cette époque.
En décembre 2023[15], en reprenant le travail de Francis Dupuis-Déri[16] et en interrogeant les personnes ayant côtoyé Hélène Rytmann les dernières semaines de sa vie, Libération conclut aussi à un féminicide typique, avec tous ses marqueurs : contrôle de son emploi du temps, souffrances gratuites infligées en la trompant à sa vue dans la mer avec une invitée, et réaction quand elle annonce vouloir le quitter. Althusser écrit « Je ne sais quel régime de vie j’imposai à Hélène (et je sais que j’ai pu être réellement capable du pire), mais elle déclara avec une résolution qui me terrifia qu’elle ne pouvait plus vivre avec moi, que j’étais pour elle un “monstre” et qu’elle voulait me quitter à jamais. [...] Elle prit alors des dispositions pratiques qui me furent insoutenables : elle m’abandonnait en ma propre présence, dans notre propre appartement. […] Cet abandon me paraissait plus insupportable que tout ». Hélène Rytmann dit elle-même, quelques jours avant son retour à Paris et son meurtre « Il est mal, il est violent, j’appréhende le retour »[6].
Hommage et contre-hommage
[modifier | modifier le code]Le , des étudiants de l'ENS décident pour lui rendre hommage de renommer la salle Aron « salle Hélène-Legotien-Rytmann ». Le directeur de l'école Frédéric Worms dit avoir redécouvert grâce à cette initiative le sujet, mais s'oppose au renommage de la salle Aron. Il promet de trouver une salle dédiée en 2024. Quelques jours plus tard, le foyer est saccagé et recouvert de tags mentionnant « À bas les féministes »[6].
Héritage
[modifier | modifier le code]Le roman de 2002 de John Banville, Shroud, est en partie inspiré par le scandale du meurtre d'Hélène Rytmann[17].
The Forward cite Hélène Rytmann comme exemple de femme juive qui a « changé la France » et suggère qu'il est « grand temps que l'on se souvienne d'Hélène Rytmann avec dignité en tant qu'individu » pour son rôle dans la Résistance française[18].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Archives de Paris, « État-civil, registre des naissances du 18e arrondissement, du 12 au 27 octobre 1910, vue 9/31, 18N 365 »
 , sur www.archives.paris.fr (consulté le )
, sur www.archives.paris.fr (consulté le )
- ↑ Archives de Paris, « État-civil du 5e arrondissement, registre des décès du 4 septembre au 21 novembre 1980, vue 29/31, 5D 319 »
 , sur www.archives.paris.fr (consulté le )
, sur www.archives.paris.fr (consulté le )
- ↑ (en) Gilbert Adair, « Getting away with murder: It's the talk of Paris – how Louis Althusser killed his wife, how he was an intellectual fraud. It's all in his posthumous autobiographical memoir. Gilbert Adair turns the pages », sur The Independent (consulté le ).
- ↑ (en) « The Paris Strangler », sur London Review of Books (consulté le )
- ↑ Dupuis-Déri, « La banalité du mâle. Louis Althusser a tué sa conjointe, Hélène Rytmann-Legotien, qui voulait le quitter= », Nouvelles Questions Féministes, vol. 34, no 1, , p. 84–101 (lire en ligne, consulté le ).
- Johanna Luyssen, « Louis Althusser et Hélène Rytmann : le philosophe assassin et le féminicide occulté », sur Libération (consulté le ).
- (en) « The murder of Hélène Rytman », sur Verso Books (consulté le ).
- ↑ (en) Elisabeth Roudinesco, Philosophy in Turbulent Times: Canguilhem, Sartre, Foucault, Althusser, Deleuze, Derrida, New York City, Columbia University Press, (ISBN 0231143001), p. 116.
- ↑ Yann Moulier Boutang, Louis Althusser : une biographie, B. Grasset, , p. 391 (ISBN 2-246-38071-5 et 978-2-246-38071-9, OCLC 26147867, lire en ligne).
- ↑ .
- ↑ Ancian, Gilbert, Hélène Legotien, Bernard Manlhiot, « Propositions pour une réorganisation des actions de développement rural », Développement et civilisations, no 38, , p. 24 - 38
- ↑ Hélène Legotien, « Note de méthode sur une activité sociologique à la SÉDÉS ». Paris, Secteur Recherche de la SÉDÉS, février 1964, 25 pages ronéotypées.
- ↑ (en) « Louis Althusser (1918–1990) », sur Pegasos (consulté le ).
- ↑ Francis Dupuis-Déry, « « La banalité du mâle. Louis Althusser a tué sa conjointe, Hélène Rytmann-Legotien, qui voulait le quitter » », Nouvelles Questions Féministes, vol. 34, no 1, , p. 84–101 (lire en ligne).
- ↑ Johanna Luyssen, « Le philosophe assassin et le féminicide occulté » », Libération, , p. 2-4 (lire en ligne).
- ↑ Francis Dupuis-Déry, Althusser assassin - La banalité du mâle, Montréal, Éditions du remue-ménage, , 96 p. (ISBN 978-2-89091-844-3, lire en ligne).
- ↑ (en) « Shroud », sur The Sydney Morning Herald (consulté le ).
- ↑ (en) « The 110 Jewish Women Who Changed France », sur The Forward (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Bibliographie
[modifier | modifier le code]- Louis Althusser, Lettres à Hélène : 1947-1980, préf. Bernard-Henri Lévy, Grasset, Paris, 2011 (ISBN 2246779618).
- Francis Dupuis-Déri, « La banalité du mâle : Louis Althusser a tué sa conjointe, Hélène Rytmann-Legotien, qui voulait le quitter », Nouvelles Questions féministes, 2015/1, vol. 34, p. 84-101.
- Johanna Luyssen, « Louis Althusser et Hélène Rytmann : le philosophe assassin et le féminicide occulté », sur Libération, (consulté le ).
- Francis Dupuis-Déri : Althusser assassin, la banalité du mâle, Édition du remue-ménage, Montréal, 2023.
Liens externes
[modifier | modifier le code]